Noël 2021 : mieux vaut être communiste et chrétien, qu’athée mais croyant
En cet anniversaire de la naissance du Christ, il est une fois de plus l'occasion, non seulement de renvoyer dos à dos le religieux intégriste et l'athée laïcard abstrait, mais également de promouvoir un christianisme rationnel, symétrique du communisme comme mouvement réel.

→ À lire aussi : Noël 2020 : l'espérance en un royaume qui n'est pas de ce monde
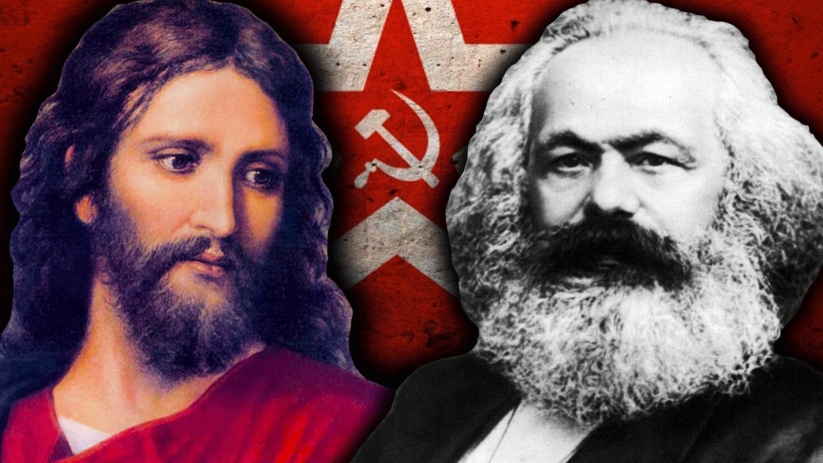 Jésus et Marx (Auteur inconnu / Source inconnue)
Jésus et Marx (Auteur inconnu / Source inconnue)
« Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu » dit la Genèse au verset 27 du 1er chapitre. C’est de cette phrase que Feuerbach tira une sorte de pastiche bien connu, d’après lequel l'Homme aurait créé Dieu à son image. Ce que Feuerbach tenait à signifier par là, c’était la dépossession, l’aliénation même, des hommes au travers de l’image qu’ils se construisaient de Dieu. L’accomplissement possible de l’humanité toute entière était relégué dans l’image qu’elle avait produite d’elle-même mais comme extérieure à elle, faute de pouvoir se réaliser ici et maintenant.
Dieu créa l’homme à son image. Il n’y a rien dans cette image qui relève déjà en propre de la représentation telle qu’on se la figure. Dire de Dieu qu’il fit (1) l’homme à son image, c’est déjà signifier autre chose que de dire que l’homme n'est que le phénomène réciproque de Dieu. Pour aller à l’essentiel : cela ne signifie pas que Dieu, comme les hommes et les femmes, aurait deux bras, deux jambes ou des poils dans les oreilles. L’image dont il est d’emblée ici question s’apparente davantage alors à celle de la liberté. Dieu fit l’homme à son image, c’est-à-dire libre. Mais c’est là d’ores et déjà que les problèmes commencent. Nous le savons, la liberté consiste moins à faire tout ce qui nous plaît (et qui souvent déplaît alors aux autres comme le remarquait Rousseau (2)) qu’à reconnaître en une l’expression d’une volonté qui soit d’abord l’expression d’une nolonté, c’est-à-dire le fait d’apprendre à ne pas nuire aux autres. La liberté encore se fait alors expression d’une volonté qui ne soit pas seulement singulière, mais collective, générale voire universelle. L’homme n’est à l’image de Dieu que lorsqu’il produit lui-même ses conditions d’existence, c’est-à-dire lorsqu’il se rend libre de tout déterminisme en comprenant ses déterminations. Il n’est pas à l’image de Dieu tel un invariant, créé et fixé, comme devant correspondre au phénomène caché de Dieu (puisque, par définition, le Dieu dont il est question ici ne se présente jamais sous aucune forme phénoménale, à l’exception de la figure du Christ, lui-même Fils de l’homme). L’homme est donc ce qui est capable de produire des transformations.
Or, tandis que le changement désigne toujours quelque chose qui se modifie pour se conserver en restant le même, la transformation consiste plutôt à dépasser la forme actuelle d’une chose. Héraclite dit bien « on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve », sous-entendu : si nous nous baignons dans la Seine aujourd’hui et demain, nous nous baignons bien toujours dans la Seine, mais l’eau dans laquelle nous nous baignons n’est plus la même le lendemain que la veille. Elle s’est changée. Il y a du changement permanent. Mais ce changement demeure le même. De la même manière, changer une roue, c’est changer par de l’identique, pour retrouver l’état originel du véhicule dont la roue vient de crever. Changer, c’est toujours remplacer par le même ou l’identique, ou bien par quelque chose de même nature (essence). Quant à la transformation, elle consiste à dépasser l’état actuel (ce qui est) et non seulement à le reproduire. Trans-former, cela veut dire aller au-delà de la forme actuelle. La culture française, par exemple, n’a cessé de se transformer au cours des siècles et notamment sa langue. C’est d’ailleurs pourquoi, dans l’œil du réactionnaire, la langue passée, la plus jeune, apparaît en même temps comme la plus enviée, tandis que la langue contemporaine est décriée alors même qu’elle relève de ce qu’il y a de plus ancien dans la langue. C’est là un paradoxe que seule une compréhension dialectique des choses permet de lever pour sortir, une fois n’est pas coutume, du carcan des fausses oppositions entre le gauchisme et la réaction. Revenons à la question de la transformation. Nous pouvons encore changer de partenaire, pour qu'un autre vienne occuper une place identique au précédent qui ne me convient plus (au risque de rencontrer de nouveau les mêmes problèmes, d’ailleurs) ou bien décider de transformer mon partenaire et/ou de nous transformer ensemble (3). Le changement implique nécessairement aussi le remplacement, la suppression de l'un par l'autre. La transformation est dialectique, elle nécessite la conservation en partie de ce qui est pour venir à partir de cela lui donner une autre forme qui peut être un contenu.
C’est à cette transformation que l’humanité œuvre pour faire advenir le royaume de Dieu, dont nous parlions déjà l’an passé, en essayant là encore de corriger les écueils d’une lecture peut-être trop hâtive ou idéologique (4). Ce royaume de Dieu, c’est en fait la finalité terrestre, ici et maintenant, qu’il nous faut construire, non comme un but final, mais bien comme une finalité à faire advenir (5). Toutefois, en tant que monistes dialectiques, nous considérons qu’il n’y a qu’une seule finalité dont les formes adviennent différemment, sur des plans et en des temps différents peut-être, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une quelconque transcendance. Il y a continuité dans la mort d’une vie différente, dont la forme matérielle ne peut plus être la même et qui n’a pas à s’apparenter à la vie telle qu’elle est connue dans le moment particulier que nous décrivons. Alors, il n’est pas possible d’appeler cela du vivant, au sens biologique régulier, mais l’arrêt de la vie et sa continuité relève davantage d’un rapport social, de ce qui fait sens intersubjectivement, que d’une définition positiviste de la science biologique qui s’occupe elle, justement, du vivant.

« Au commencement était le Verbe. », écrit Saint Jean dans son prologue. Deux choses nous interpellent ici. D’abord l’idée de commencement. Il est admis d’ordinaire que ce qui se trouve au commencement, s’y trouve chronologiquement, c’est-à-dire au point de départ. Il n’y a pas a priori de commencement qui puisse être en même temps une fin. Pourtant, comme le soulignait déjà très bien Kant à propos du premier conflit des idées transcendantales dans la Critique de la Raison pure :
« (…) Admettons que le monde ait un commencement. Comme le commencement est une existence précédée d’un temps où la chose n’est pas, il doit y avoir un temps antérieur où le monde n’était pas, c’est-à-dire un temps vide. Or, dans un temps vide il n’y a pas de naissance possible de quelque chose, parce qu’aucune partie de ce temps n’a en soi plutôt qu’une autre une condition distinctive de l’existence, plutôt que de la non-existence. Donc, il peut bien se faire que plusieurs séries de choses commencent dans le monde, mais le monde lui-même ne peut pas avoir de commencement (…). »
Emmanuel Kant, Critique de la raison pure, trad. A. Tremesaygues et B. Pacaud, Paris, Quadrige/Puf, 2008, p. 336
Au commencement était le Verbe. Il ne s’agit pas là d’un commencement chronologique, mais téléologique. Ce qui est désigné par là, c’est la puissance que peuvent avoir les hommes à organiser le monde et à s’émanciper du seul Univers (6). Il est malheureux de voir à quel point l’esprit se satisfait si vite, nous dit Hegel. Et nous le voyons encore avec l’idée de Dieu, qui, prise comme telle, c’est-à-dire comme image de l’homme, s’évapore au moins depuis Kant, faute de preuve ontologique ! Toutefois, l’erreur porte moins sur ce que Dieu désigne en tant que production humaine que sur le fait que l’humanité ait pu s’imaginer un être transcendant avec la capacité de sortir de lui-même, puisque l’être à l’origine du monde ne ferait en même temps pas partie de ce monde et devrait alors être inclus à l’intérieur d’un autre monde, sans que cela ne puisse prendre fin.
Il nous faut prendre à rebours toute idée idéaliste du commencement, pour y soustraire un principe dialectique. Dès lors, le commencement n’est plus point de départ, mais automouvement, devenir et résultat. Il nous faut alors nous poser la question de l’origine, et nous demander si une chose n’est pas toujours déjà contenue en même temps dans son origine : Christ, Fils de l’homme. Autrement dit, le commencement n’est pas le fondement et Dieu est dans toute la tradition ce qui est bâti, c’est-à-dire une origine qui est toujours déjà-là et qui n’a pas à s’interpréter dans une chronologie mais seulement sur le plan téléologique (ce qui vise une finalité) (7). Ce commencement n’est pas un début, il est l’expression d’un moment, compris dans l’automouvement permanent du devenir. Il n’y a que du devenir (8).
Maintenant, intéressons-nous au verbe. C’est le logos. Le verbe s’est fait chair et la chair a produit le verbe. Le logos accepte bien des traductions, celles de « discours » ou « parole » sont les plus courantes. Toutefois, logos renvoie encore à l’idée de rassemblement, au fait de recueillir, d’unifier, en lien avec l’intellect. Il est l’Un-Tout, pour reprendre la proposition d’Héraclite. La parole n'est pas davantage superflue que le symbolique ou que des éléments d’entités immatérielles. Au contraire, elles sont le propre d’une matérialité dont tout scientifique en sciences humaines prend la mesure. Que disait Marx du langage ?
« Dès le début, une malédiction pèse sur "l'esprit", celle d'être "entaché" d'une matière qui se présente ici sous forme de couches d'air agitées, de sons, en un mot sous forme du langage. Le langage est aussi vieux que la conscience, — le langage est la conscience réelle, pratique, existant aussi pour d'autres hommes, existant donc alors seulement pour moi-même aussi et, tout comme la conscience, le langage n'apparaît qu'avec le besoin, la nécessité des échanges avec d'autres hommes. »
Le logos se veut alors principe intersubjectif, expression même d’un monde, du monde, celui de rapports sociaux consentis ou subis, bref, l’expression même de la vie humaine.
Au commencement était le Verbe. Cela ne signifie nullement qu’au point de départ, qu’au moment d’une seule et unique origine fixe, une parole dématérialisée et transcendante produisit tout ce qui est. Au contraire, dans la structuration des causalités libres, celle d’une téléologie inscrite dans les actions humaines, cela signifie la possibilité pour les hommes, en tant que sujet collectif, de donner un sens et par là, en même temps, une finalité à la production humaine et à l’histoire. Le logos est recueillement et organisation, il est ce par quoi nous produisons nos conditions d’existence en commun, il est l’expression de l’intersubjectivité. C’est en ce sens que Dieu est en chacun de nous et surtout par chacun de nous et par là bien plus un résultat qu’un commencement au sens couramment entendu. C’est notre capacité à faire signe au sein d’un système humain.
Régis Debray a raison en ce sens de dire que « l’idéologie, ça ne se passe pas là où l’on croit, dans la sphère des idées. » (9) et d’ajouter que les processus religieux sont avant tout des processus d’organisation plus que des représentations mentales (10). La religion, comme le logos, relient. Ce n’est pas pour rien alors que les fonctions politico-religieuses se trouvent aux fondements de toutes les sociétés. Les formes divergent d’une époque à l’autre, mais le contenu des questionnements demeure le même et en cela il est universel. C’est d’ailleurs cet universalisme-là, celui de la compréhension, qu’il nous faut conserver du christianisme, contre un universalisme abstrait de la seule extension (11). Il y a toujours du sacré et du religieux (12) comme fondement des sociétés, et le chasser à grand coup de discours performatif, c’est le faire revenir comme un éléphant dans la pièce dans le meilleur des cas, comme une illusion dans le pire des cas : celle de se croire prémuni de toute croyance, parce qu’athée. Il en va ainsi de l’extension idéologique et religieuse de l’écologisme.
Nous nous retrouvons face à deux écueils. Le premier : mettre à la porte toute forme de sacré quitte à le voir revenir par la fenêtre. Le second : créer une artificialité du divin, l’Être suprême si cher à la Révolution française. Dès lors, comme l’écrit Michel Clouscard : « Dieu existe, Dieu n'existe pas ? La praxis est indifférente à cet énoncé. Elle peut, pour des raisons historiques, postuler Dieu, comme Rousseau. Mais cette question reste subsidiaire. La praxis, elle, est cause d'elle-même. Et cela suffit à la justifier comme unique référence politique. L'existence de Dieu est le problème de Dieu et non de l'humanité (en d'autres termes, le marxisme a aboli la religion et la philosophie). Si Dieu existe, tant mieux pour lui. La praxis est la preuve que l'homme en est digne. Le divin nous serait alors donné de surcroît. Quelle bonne surprise, divine surprise. » (13)
L’athéisme n’est certainement pas un moyen et ne peut au mieux qu’être une conséquence, ce que Marx soulignait d’ailleurs déjà très bien dans sa Critique de la philosophie du droit de Hegel.

Mais plus encore, un christianisme rationnel, qui ne soit pas hors-sol, mais qui soit le symétrique du communisme comme mouvement réel (comme commencement, entendu comme causalité libre, c’est-à-dire comme praxis) vers la finalité que l’humanité est en droit de se donner face aux mystifications, au mensonge, à l’athéisme (comme nouvelle forme idéologique visant à noyer le poisson) c’est peut-être là que siège la force à la fois de notre héritage et du présent à construire maintenant. « Si Dieu n’existe pas, tout est permis » (Dostoïevski) et pourtant, rien n’y fait, tout n’est permis qu’à une petite minorité, celle-là même qui se servait autrefois du pouvoir de l’Église pour continuer à asseoir sa domination et qui aujourd’hui use du nihilisme pour se pérenniser. À rebours de cela, une conciliation est possible, et la laïcité, conception très française de l’articulation du politique et du religieux, si mal comprise, nous apparaît comme le progrès le plus avancé jusqu’à aujourd’hui pour que nous marchions communément vers une république sociale, démocratique, communiste, qui récuse à la fois toute forme d’ostentation abstraite tout en comprenant (en ayant en soi) l’expression même des acquis du sacré dans l’héritage d’une nation. Cette laïcité qui s’inscrit en propre, dès l’origine, dans le christianisme. Il n’y a rien d’anodin alors à ce que ce soit celle-ci qui émerge politiquement au sein de la fille aînée de l’Église : même histoire dialectique que celle du développement des sciences au sein d’une Europe pourtant catholique qui nous est toujours présentée comme ayant été hostile à ce développement (14).
En Luc 11:52, il est écrit : « Malheur à vous, docteurs de la loi ! Parce que vous avez enlevé la clef de la science ; vous n'êtes pas entrés vous-mêmes, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient (…) (15) »
Alors, méfions-nous, méfions-nous de ceux qui se parent d’être défaits de toute croyance, de ceux qui en matière de politique comme en matière de sciences, quelles qu’elles soient, ne voient que par le positivisme. Ils nous proposent un monde où tout est fait de scepticisme mais où toutes les vérités idéologiques sont communément admises.
Joyeux Noël.
Notes et références :

Écologisme et sacré : le cas d'Extinction Rebellion

Barrès en héritage







L'ombre de Jacques Vergès

Emballage de l’Arc de Triomphe : Comment critiquer l’art contemporain ?
 Voir la bibliothèque
Voir la bibliothèque
 Acheter les livres
Acheter les livres
 Écouter Marx FM
Écouter Marx FM




























