Pérou : le président évincé par la tyrannie du parlementarisme bourgeois
La récente éviction du président péruvien Pedro Castillo illustre le caractère vicieux d'un parlement au service de la classe dominante et doté de pouvoirs démesurés.

Pedro Castillo a été élu président du Pérou en juillet 2021, à la surprise générale. L’élection était en effet censée se jouer entre deux candidats bourgeois qui s’accordaient pour le maintien de l’ordre établi capitaliste. Pérou libre, un parti de gauche radicale marxiste, a été le premier parti opposé au capitalisme à accéder au second tour de l’élection présidentielle péruvienne depuis la fin des années 1970. Son programme prévoyait notamment la nationalisation des principales ressources naturelles, des investissements massifs dans l’éducation et plus généralement une rupture avec la politique néolibérale imposée aux péruviens depuis les années 1990 par la bourgeoisie péruvienne, affidée de l’impérialisme états-unien. Castillo vient d’un milieu pauvre et rural. Pendant sa campagne présidentielle, il vivait encore dans une maison en pierre sans électricité ni sanitaires. Il a réussi à fédérer toute la gauche péruvienne autour de lui et à battre de justesse Keiko Fujimori, fille de l’ancien dictateur Alberto Fujimori, président du Pérou de 1990 à 2000, allié indéfectible des États-Unis, responsable de massacres et d’une campagne de stérilisation des femmes indigènes qui fit 200 000 victimes.
Tout l’appareil médiatique bourgeois a d’emblée pris position contre Castillo, qui fut dépeint comme un dangereux communiste qui allait commettre des meurtres de masse s’il était élu. Il faut savoir que l'anticommunisme reste très fort au Pérou depuis le conflit armé des années 1980 et 1990 au cours duquel le gouvernement péruvien fit face à la guérilla du Sentier lumineux, organisation maoïste de Gonzalo. Il est donc facile de jeter l’anathème sur une personnalité politique au Pérou en l’accusant de liens avec le Sentier lumineux. Plus profondément, il est très difficile pour un candidat progressiste d’être élu et, une fois élu, d’agir au Pérou. En effet, le dictateur Fujimori a mis en place un système politique extrêmement difficile à changer pour assurer la pérennité des politiques néo-libérales favorables aux États-Unis. Pour cela, il a promulgué une nouvelle constitution qui donne le pouvoir législatif à une unique chambre de 123 membres, ce qui fait que le congrès peut facilement adopter des lois et qu’il y a peu de contre-pouvoirs. Dans ce système truqué et verrouillé, Castillo a été incapable de mener à bien la moindre réforme. Toutes ses propositions ont été rejetées en bloc par le congrès. La seule chose qu’il pouvait faire était de promulguer des décrets présidentiels, mais les médias le désignaient alors comme un horrible dictateur. Ne parlons pas de ses origines indigènes et paysannes qui lui ont valu un tombereau d’injures racistes et un mépris de classe de la part de toute la classe politico-médiatique bourgeoise.
La constitution de Fujimori permet au congrès de destituer le président s’il constate son incapacité « physique ou morale » à ses fonctions. Que signifie « incapacité morale » ? À peu près tout ce qui arrange le congrès ! Sur la base de cet article scélérat, l’un des prédécesseurs de Castillo, Martin Vizcarra, avait déjà été destitué par le congrès en novembre 2020. Ce monsieur était un néo-libéral des plus respectables et défendait un programme approuvé par le congrès mais a tout de même été prié de déguerpir à la suite d’accusations douteuses de corruption. Dès lors, il n’est pas étonnant qu’un président progressiste et même marxiste comme Castillo se soit rapidement attiré les foudres d’un congrès dominé par Force populaire, le parti de la famille Fujimori, et ses alliés de tendances diverses mais tous libéraux et pro États-Unis. Dès août 2021, soit moins d’un mois après l’élection de Castillo, la presse bourgeoise péruvienne évoquait la possibilité d’une éviction du président nouvellement élu pour incapacité morale et une première procédure pour tenter de le destituer a été lancée en octobre, quatre mois après l’élection. Un deuxième vote a eu lieu quatre mois plus tard et a échoué de justesse, alors que Castillo avait déjà renoncé à appliquer une grande partie de son programme, faute de soutien. Cette épée de Damoclès l'empêchait de faire quoi que ce soit. Le 7 décembre, un nouveau vote de destitution devait avoir lieu. Castillo aurait peut-être pu s’en sortir mais, pour conserver son poste, il aurait dû continuer à renoncer à appliquer son programme, ce qui était perçu comme une trahison par ses électeurs. C’est pourquoi il a pris la parole à la télévision nationale pour annoncer la dissolution du congrès et la convocation d’une assemblée constituante pour se débarrasser de l’inique constitution en vigueur et en rédiger une nouvelle. C’était une manœuvre téméraire. En effet, la constitution péruvienne prévoit que le président n’a le droit de dissoudre le congrès que si deux nominations ministérielles lui sont refusées, ce qui n’était pas arrivé. Les médias bourgeois ont immédiatement crié au coup d’État. En France, Le Figaro compare l’acte de Castillo à ce qu’avait fait Alberto Fujimori en son temps. Ces gens peuvent se draper dans le respect des sacro-saintes institutions mais sont en réalité plus préoccupés par la sauvegarde d’un régime sclérosé, manifestement impossible à réformer et mis en place au bénéfice de la classe dominante, que par le progrès social réel. Tous ceux qui aujourd’hui conspuent Castillo lui reprochent en fait d’avoir tenté de briser le carcan qui l’empêchait de faire ce pour quoi il avait été élu par le peuple souverain.
Malheureusement, la manœuvre avait de faibles chances d’aboutir puisque tout l’appareil médiatique et toutes les institutions étatiques étaient opposées à Castillo, police et armée comprises. En à peine trois heures, les militaires ont désavoué le président, le congrès a avancé sa séance, a voté la destitution et a fait arrêter et jeter en prison le désormais ex-président. Le mandat de Pedro Castillo restera ainsi dans l’histoire comme l’exemple malheureux de l’impossibilité totale de transformer en profondeur un système créé par la bourgeoisie pour la bourgeoisie, en s’en tenant au strict cadre légal et institutionnel.

Écologisme et sacré : le cas d'Extinction Rebellion

Barrès en héritage







L’Ukraine en guerre contre elle-même

Mois de carnages aux États-Unis
 Voir la bibliothèque
Voir la bibliothèque
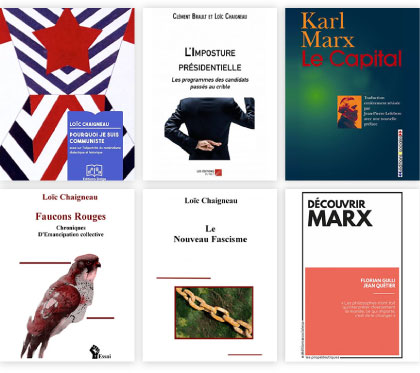 Acheter les livres
Acheter les livres
 Écouter Marx FM
Écouter Marx FM


























