Qu’est-ce que la médecine ? La leçon d'Hippocrate
Hippocrate, premier des grands médecins, nous ramène aux fondements de la médecine : elle est un savoir-faire qui allie la théorie à la pratique.

Cet article fait partie d'un dossier complet sur la médecine. Les arguments qui y sont développés s'inscrivent donc dans une totalité. CF : le sommaire.
La crise du COVID-19 comme symptôme de la maladie capitaliste
Qu'est-ce que le vivant ? Un bref horizon des réponses philosophiques et scientifiques
Qu’est-ce que la médecine ? La leçon d'Hippocrate
La médecine prise en otage : Entre scientisme et pseudo-science
Des lobbys corrompus aux charlatans de province : Conséquences et dérives de la médecine bourgeoise
Refondation thérapeutique : Propositions pour une pratique communiste de la santé
Nous savons maintenant que la médecine a pour objet la capacité de l’organisme à maintenir les constantes physiologiques à un état d’équilibre ainsi que son rétablissement grâce à une thérapie adaptée. Avec l’apport de la psychologie, nous savons aussi que l’objectif de la médecine est le rétablissement ou le maintien des patients dans un état d’équilibre physiologique et psychique. La médecine a pour fin de limiter ou de guérir la pathologie des patients, sur la base de normes théoriques fondées sur des moyennes de mesures (qualitatives et quantitatives) obtenues par la science.
Mais quelle est la nature de la médecine ? A priori, la médecine se présente comme une discipline extrêmement savante regroupant une immensité de connaissances scientifiques. La première chose à laquelle on pense quand l’on nous parle d’un étudiant en médecine n’est-elle pas la quantité de travail demandée pour l’acquisition de l’ensemble des savoirs nécessaires à l’obtention du diplôme ? Pourtant, la médecine existe depuis beaucoup plus longtemps que les facultés modernes qui l’enseignent.
On a pour habitude de la faire remonter à Hippocrate, un médecin de l’antiquité grecque que l’on considère comme père de la médecine. Mais sans doute devait-on déjà soigner à l’aide de diverses méthodes dès la préhistoire. On a par exemple retrouvé sur le cadavre d’Ötzi — un homme momifié naturellement dans les glaciers des Alpes vers 3300 av. J.-C. —, un sac de champignons vermifuges (polypores du bouleau) (1). Et il s’est avéré à l’analyse qu’il avait des vers dans l’intestin. Sans doute ces champignons devaient-ils constituer son traitement.
 Reconstitution de la momie de Ötzi présentée au musée de Préhistoire de Quinson (120 / Wikipédia)
Reconstitution de la momie de Ötzi présentée au musée de Préhistoire de Quinson (120 / Wikipédia)
La médecine ne date donc pas de ce que nous appelons aujourd’hui la médecine expérimentale. Le détour par la science théorique est un événement plutôt récent dans l’histoire de la médecine si on la mesure à l’aune des premières tentatives de soins dans l’histoire de l’humanité. Les « médecins » ou soigneurs de l’époque n’administraient évidemment pas leurs soins à l’aveugle. On peut dire qu’ils testaient les effets de certaines plantes ou exercices sur l’état des malades et se transmettaient de génération en génération la somme du résultat de leur approche empirique. Dans la majeure partie de son histoire, la médecine a donc avant tout été un art plutôt qu’une science, c’est-à-dire, dans la conception d’Aristote, un savoir-faire.
Si l'enseignement d'Hippocrate (2) n'est pas un horizon indépassable, on doit avoir en tête que son travail apparaît comme la première grande formulation de cette pratique plurimillénaire. Il est donc une figure tutélaire de la médecine ; encore aujourd'hui son Serment sert de fondation éthique pour les médecins du monde entier. On peut synthétiser son enseignement en cinq points :
En premier lieu, ne pas nuire.
La nature est guérisseuse.
Identifier et traiter la cause.
Détoxifier et purifier l’organisme.
Enseigner.
Le premier principe est un principe éthique qui traverse l’ensemble de la pratique médicale. Il stipule que le rôle du médecin est de garantir le meilleur état de santé possible au patient. Cela suppose du médecin une connaissance absolue de ce qu’il fait, mais aussi une très grande responsabilité. Ce dernier doit peser les bénéfices et les risques des traitements qu’il administre en minimisant au maximum les risques qu’il fait encourir au malade. Ce principe va encore plus loin : ne pas nuire signifie également promouvoir auprès des patients des comportements qui participent à la conservation de la bonne santé. Le médecin n’a donc pas seulement pour rôle de traiter les malades, mais il a aussi un rôle de prévention auprès de tous.
Le second principe peut être compris de deux manières. Tout d’abord, comme un appel à l’utilisation de remèdes dits « naturels » — nous reviendrons sur les problèmes que ce terme soulève quand nous étudierons à titre critique la naturopathie —, c’est-à-dire les médications à base de plantes, etc. Mais de manière plus subtile, il indique surtout le rôle régulateur du corps sur lui-même en préfigurant le principe d’homéostasie que nous avons évoqué plus haut. On retrouve alors l’idée d’équilibre du vivant. Par « nature », Hippocrate dit que, dans les conditions environnementales adéquates, le corps peut retrouver son équilibre tout seul. En un sens, il peut « s’auto-soigner » si on le met dans des dispositions adéquates.
Le troisième principe nous enseigne qu’on ne traite pas une maladie en éliminant ses symptômes mais en la prenant en charge à la cause du trouble. Bien sûr, cela n’exclut pas de limiter certaines manifestations de la maladie, à condition de ne pas nuire, comme par exemple certaines douleurs insupportables. Mais il est crucial de traiter d’abord l’origine du mal. Couplé au deuxième principe, on en déduit que bon nombre de maladies sont avant tout le fruit d’un dysfonctionnement ou d’un déséquilibre émanant du corps et non d’une perturbation extérieure. Dans le cas où l’origine de la maladie serait intraitable, comme dans les maladies génétiques, c’est le premier principe qui prime. C’est-à-dire de ne pas nuire à partir de ce terrain et de faire recouvrir au maximum ses capacités à l’individu.
Le quatrième principe prolonge le précédent. Il nous invite à penser la thérapeutique en termes de cure. Si l’origine de la maladie est interne au corps et que la santé est une question d’équilibre, c’est que ce qui provoque la maladie est un trop ou un manque de quelque chose, que ce soit des nutriments, de sommeil, de relations sociales, etc. Une vie en bonne santé est donc une vie qui permet la pratique régulière de cure, en plus d’une hygiène quotidienne.
Enfin, le cinquième principe pose la médecine dans un rapport social. L’enseignement est non seulement celui des médecins aux apprentis médecins, mais aussi du médecin au malade et à la société en général. On rejoint ici ce que nous disions sur le rapport du médecin au malade dans notre partie précédente. La santé et les pratiques qui en découlent nous invitent, comme la philosophie, à suivre l’injonction pythique à nous « connaître nous-même » pour être maître de ce que nous faisons. C’est un enjeu politique de taille car il n’existe pas de République viable si elle est composée de citoyens malades. La connaissance des principes de la médecine est un impératif démocratique, la récente crise du COVID-19 l’a suffisamment montré.
 Hippocrate refusant les présents d'Artaxerxès (Anne-Louis Girodet / Wikipédia)
Hippocrate refusant les présents d'Artaxerxès (Anne-Louis Girodet / Wikipédia)
L’enjeu ici n’est absolument pas de remettre en cause les avancées de la médecine expérimentale. Au contraire, et nous avons suffisamment insisté là-dessus, nous pensons que la science est un des plus grands acquis de la médecine. Mais si la médecine a eu besoin d’un détour par les sciences du vivant puis les sciences de la psyché pour asseoir sa pratique sur des faits démontrés et objectivés par des mesures, mais également par la science technique qui a développé les moyens matériels révolutionnaires en matière de soin, elle ne peut pas se définir comme une discipline purement théorique.
En tant que savoir-faire, la médecine est une pure manifestation de la praxis qui relie dialectiquement le geste et la pensée au sein d’un rapport social, mais elle n’est en aucun cas une simple théorie à appliquer de manière abstraite. La médecine est donc avant tout une pratique.
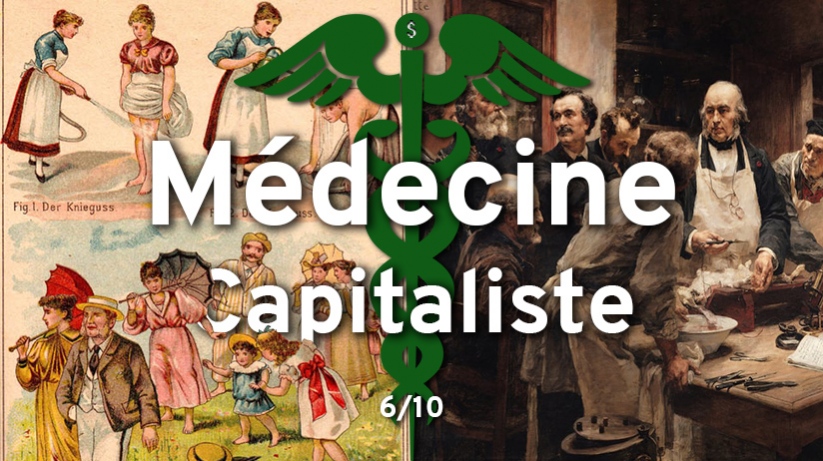 Montage Naturopathie et Médecine expérimentale (Affranchi / Affranchi)
Montage Naturopathie et Médecine expérimentale (Affranchi / Affranchi)
Sources :
Sources images :
Auteur inconnu : Publication byzantine du XIIe siècle du serment d'Hippocrate

Écologisme et sacré : le cas d'Extinction Rebellion

Barrès en héritage







Du déracinement des identitaires au ré-enracinement des communistes

L'État selon Michel Clouscard
 Voir la bibliothèque
Voir la bibliothèque
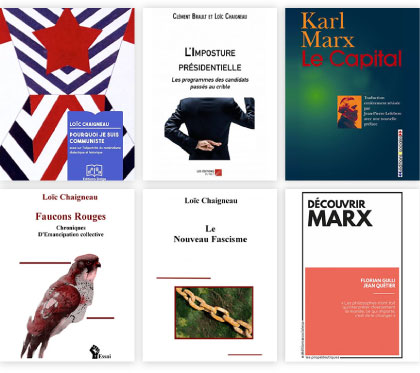 Acheter les livres
Acheter les livres
 Écouter Marx FM
Écouter Marx FM


























